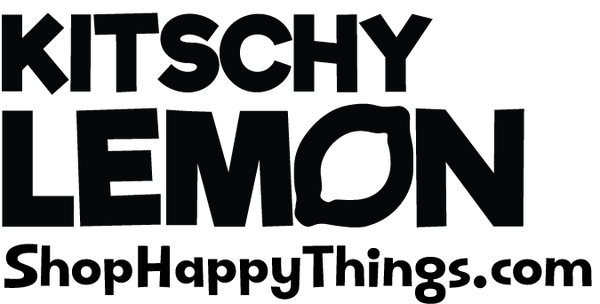Guillaume Apollinaire's Artistic Manifesto, L’ESPRIT NOUVEAU ET LES POÈTES Translated to English
L’ESPRIT NOUVEAU
ET LES POÈTES
"The New Spirit and the Poets"
Guillaume Apollinaire
(This translation was gathered using ChatGPT 4o on 3/16/2025, maintaining a word-for-word approach as much as possible while ensuring clarity.)
The new spirit that will dominate the entire world has not emerged in poetry anywhere as it has in France. The strong intellectual discipline that the French have imposed upon themselves at all times allows them, and those who belong to them spiritually, to have a conception of life, of the Arts, and of Letters that, without being a simple acknowledgment of Antiquity, is also not merely a counterpart to the beautiful romantic decor.
The new spirit that is emerging claims above all to inherit from the classics a solid common sense, a sure critical mind, an overall view of the universe and the human soul, and a sense of duty that strips emotions and limits or rather contains their manifestations.
It also claims to inherit from the romantics a curiosity that drives it to explore all domains capable of providing literary material that allows the exaltation of life in whatever form it may present itself.
Exploring truth, seeking it, whether in the ethnic domain, for example, or in that of imagination—these are the main characteristics of this new spirit.
This tendency, moreover, has always had its bold representatives who were unaware of it; it has been forming for a long time, it has been in motion.
However, it is the first time that it presents itself consciously. That is because, until now, the literary domain was confined within narrow limits. One wrote in prose or one wrote in verse. As for prose, grammatical rules determined its form.
As for Poetry, rhymed versification was its sole law, which periodically endured assaults, but which nothing could undermine.
Free verse gave free rein to lyricism, but it was only a stage in the explorations that could be undertaken in the domain of form.
Research in form has now regained great importance. It is legitimate.
How could this research not interest the poet, when it can lead to new discoveries in thought and lyricism?
Assonance, alliteration, as well as rhyme, are conventions, each of which has its merits.
Typographical artifices, pushed very far with great audacity, have the advantage of giving rise to a visual lyricism that was almost unknown before our time. These artifices can go even further and consummate the synthesis of arts, music, painting, and literature.
There is nothing here but research aimed at achieving new expressions that are perfectly legitimate.
Who would dare to say that rhetorical exercises, variations on the theme of I die of thirst beside the fountain, did not have a determining influence on Villon's genius? Who would dare to say that the formal research of the rhetoricians and the Marotic school did not serve to refine French taste up to its perfect flowering in the 17th century?
It would have been strange that, in an era where the popular art par excellence, cinema, is a picture book, poets had not tried to compose images for the meditative and more refined minds who do not content themselves with the crude imaginations of film manufacturers. These, too, will refine, and one can foresee the day when, with the phonograph and cinema having become the only forms of recorded expression in use, poets will have an unknown freedom until now.
Let no one be surprised if, with the only means still at their disposal, they strive to prepare for this new art (broader than the simple art of words), where, as the conductors of an orchestra of unprecedented scale, they will have at their disposal: the entire world, its murmurs and its appearances, human thought and language, song, dance, all the arts and all artifices, more mirages still than those that Morgane could conjure up on Mount Gibel, to compose the seen and heard book of the future.
But generally, in France, you will not find these words in freedom to the extent that the excessive futurist outbidding, Italian and Russian, has pushed them—those being excessive daughters of the new spirit—because France abhors disorder. One readily returns to principles, but one detests chaos.
We can therefore hope, regarding the material and means of art, for an unimaginable opulence of freedom. Poets are today learning this encyclopedic freedom. In the domain of inspiration, their freedom can be no less than that of a daily newspaper, which, in a single sheet, deals with the most diverse subjects, travels through the most distant countries. One wonders why the poet should not have at least an equal freedom and be required, in an era of telephones, wireless telegraphy, and aviation, to be more circumspect about space.
The speed and simplicity with which minds have become accustomed to designating, in a single word, beings as complex as a crowd, a nation, or the universe, had no modern equivalent in poetry. Poets are filling this gap, and their synthetic poems create new entities that have a plastic value as composite as collective terms.
Man has familiarized himself with those formidable beings that are machines, he has explored the realm of the infinitely small, and new domains are opening to the activity of his imagination: that of the infinitely large and that of prophecy.
However, do not believe that this new spirit is complicated, languid, artificial, or cold. Following the very order of nature, the poet has rid himself of all bombastic discourse. There is no more Wagnerian influence within us, and young authors have cast far from them all the enchanted trappings of Germany’s colossal romanticism, as well as the pastoral rags brought to us by Jean-Jacques Rousseau.
I do not believe that social events will ever go so far that one can no longer speak of national literature. On the contrary, however far one may go in the path of freedoms, these will only reinforce most of the ancient disciplines, and new ones will emerge that will be no less demanding than the old ones. That is why I think that, whatever happens, art will have a homeland more and more. Moreover, poets are always the expression of a milieu, of a nation, and artists, like poets and philosophers, form a social foundation that undoubtedly belongs to humanity, but as the expression of a race, of a given environment.
Art will cease to be national only on the day when the entire universe, living under the same climate, in dwellings built to the same model, speaks the same language with the same accent—that is to say, never. From ethnic and national differences arises the variety of literary expressions, and it is precisely this variety that must be safeguarded.
A cosmopolitan lyrical expression would only produce vague works, without accent and without structure, works with the value of the commonplace rhetoric of international parliamentary speeches. And note that cinema, which is the cosmopolitan art par excellence, already presents ethnic differences that are immediately distinguishable to everyone, and those accustomed to the screen can immediately tell the difference between an American film and an Italian film. Likewise, the new spirit, which aspires to leave its mark on the universal spirit and does not intend to limit its activity to this or that, is nonetheless—and claims to be—a particular and lyrical expression of the French nation, just as the classical spirit is, par excellence, a sublime expression of the same nation.
We must not forget that it may be more dangerous for a nation to be intellectually conquered than to be conquered by arms. That is why the new spirit claims above all to be part of order and duty, which are the great classical qualities by which the French spirit manifests itself most eminently, and it combines them with freedom. This freedom and this order, which merge within the new spirit, are its characteristic and its strength.
However, this synthesis of the arts, which has been accomplished in our time, must not degenerate into confusion. That is to say, it would be, if not dangerous, at least absurd, for example, to reduce poetry to a kind of imitative harmony that would not even have the excuse of being precise.
One can very well imagine that imitative harmony might play a role, but it could only be the basis of an art in which machines intervene; for example, a poem or a symphony composed for the phonograph could very well consist of sounds artistically chosen and lyrically blended or juxtaposed, whereas I personally struggle to conceive that one could simply make a poem out of the imitation of a noise to which no lyrical, tragic, or pathetic meaning can be attached. And if some poets engage in this game, it should only be seen as an exercise, a sort of sketch of notes that they will insert into a larger work. The brékéké koax of the Frogs by Aristophanes is nothing if separated from the work in which it takes on all its comic and satirical meaning. The prolonged iiii stretching across an entire line in Francis Jammes’ The Bird is of little imitative harmony if detached from a poem in which it specifies all the fantasy.
When a modern poet notates the buzzing of an airplane in multiple voices, it must be seen above all as the poet’s desire to train his mind to reality. His passion for truth pushes him to take notes that are almost scientific, which, if he presents them as poems, have the fault of being, so to speak, mere trickery of the ears, where reality will always be superior.
On the other hand, if he wishes, for example, to amplify the art of dance and attempt a choreography in which dancers would not limit themselves to leaps but would also produce cries that would belong to the harmony of a new imitative expression, that would be a legitimate pursuit, with popular sources found among all peoples, where war dances, for example, are almost always accompanied by wild cries.
Returning to the concern for truth, for verisimilitude, which dominates all the research, all the attempts, all the experiments of the new spirit, one must add that it is not surprising if a certain number, even many of them, remain momentarily sterile or even fall into ridicule. The new spirit is full of dangers, full of pitfalls.
Yet, all of this belongs to the spirit of today, and to condemn these attempts, these experiments outright would be to make an error of the kind that, rightly or wrongly, is attributed to M. Thiers, who supposedly declared that railroads were merely a scientific game and that the world could never produce enough iron to lay tracks from Paris to Marseille.
The new spirit therefore accepts literary experiments, even risky ones, and these experiments are sometimes not very lyrical. That is why lyricism is only one domain of the new spirit in today’s poetry, which often contents itself with research, investigations, without worrying about giving them lyrical significance. These are materials that the poet, that the new spirit, accumulates, and these materials will form a foundation of truth, whose simplicity and modesty should not be off-putting, for the consequences, the results, may be great, very great indeed.
Later, those who study the literary history of our time will marvel that, like alchemists, dreamers and poets could, without even the pretext of a philosopher’s stone, devote themselves to research and notations that made them the object of ridicule by their contemporaries—journalists and snobs alike.
But their research will be useful; they will constitute the foundations of a new realism that may not be inferior to the poetic and erudite realism of ancient Greece.
We have also seen, since Alfred Jarry, laughter rise from the low regions where it writhed and provide poets with an entirely new lyricism. Where is the time when Desdemona’s handkerchief seemed unbearably ridiculous? Today, ridicule itself is sought after, people try to seize it, and it has its place in poetry because it is as much a part of life as heroism and all that once nourished the enthusiasm of poets.
The romantics tried to give things of crude appearance a sense of horror or tragedy. More precisely, they worked only in favor of horror. They wanted to acclimate horror much more than melancholy. The new spirit does not seek to transform the ridiculous; it preserves it in a role that is not without charm. Likewise, it does not wish to give horror a noble meaning. It leaves it as horror and does not lower the noble. It is neither a decorative art nor an impressionist art. It is entirely a study of external and internal nature, it is entirely ardor for truth.
Even if it is true that there is nothing new under the sun, it does not consent to ignoring everything that is not new under the sun. Common sense is its guide, and this guide leads it to corners that, if not new, are at least unknown.
But is there really nothing new under the sun? That remains to be seen.
What! They have X-rayed my head. I have seen, while still alive, my own skull, and that would not be something new? Tell that to someone else!
Solomon was surely speaking only for the Queen of Sheba, and he loved novelty so much that his concubines were countless.
The skies are now populated with birds that are strangely human. Machines, daughters of man who have no mother, live a life in which passions and feelings are absent—and this would not be new!
Scientists constantly scrutinize new universes that reveal themselves at every intersection of matter, and there would be nothing new under the sun? Maybe for the sun. But for men?
There are a thousand and a thousand natural combinations that have never been composed before. They imagine them and bring them to life, thereby composing with nature this supreme art that is life itself. It is these new combinations, these new works of the art of life, that we call progress. In this sense, progress exists. But if one makes it consist of an eternal becoming, in a kind of messianism as dreadful as the fables of Tantalus, Sisyphus, and the Danaids, then Solomon is right against the prophets of Israel.
But novelty does exist, without necessarily being progress. It lies entirely in surprise. The new spirit is also in surprise. That is what makes it most alive, most fresh. Surprise is the great new driving force. It is through surprise, through the important place it gives to surprise, that the new spirit distinguishes itself from all the artistic and literary movements that preceded it.
Here, it breaks away from them all and belongs only to our time.
We have established it on the solid foundations of common sense and experience, which have led us to accept things and feelings only according to truth, and it is according to truth that we admit them, without seeking to make sublime what is naturally ridiculous or vice versa. And from these truths, surprise most often arises, since they go against commonly accepted opinion. Many of these truths had never been examined. It is enough to reveal them to cause surprise.
One can also express a supposed truth that causes surprise because no one had dared to present it before. But a supposed truth does not stand in opposition to common sense, otherwise, it would no longer be truth, even hypothetical truth. Thus, if I imagine that, should women stop bearing children, men could take on that role, and if I show it, I express a literary truth that could only be qualified as a fable outside of literature, and I create surprise. But my supposed truth is no more extraordinary nor more implausible than those of the Greeks, who showed Minerva emerging, fully armed, from Jupiter’s head.
As long as airplanes did not populate the sky, the fable of Icarus was merely a supposed truth. Today, it is no longer a fable. And our inventors have accustomed us to wonders greater than the one that would consist of delegating to men the function that women have in childbirth. I will go even further: since most fables have come true and beyond, it is up to the poet to imagine new ones that inventors may in turn bring to life.
The new spirit demands that we take on these prophetic tasks. That is why you will find traces of prophecy in most works conceived according to the new spirit. The divine play of life and imagination gives rise to an entirely new poetic activity.
For poetry and creation are one and the same thing; one should only be called a poet if one invents, if one creates, to the extent that a human can create. The poet is the one who discovers new joys, even if they are difficult to endure. One can be a poet in any field: all that is required is to be adventurous and to set out on a journey of discovery.
The richest, least known domain—the one whose extent is infinite—is that of imagination, so it is not surprising that the name "poet" has been reserved in particular for those who seek the new joys that mark the vast and immense spaces of the imaginative realm.
The slightest fact is, for the poet, the postulate, the starting point of an unknown vastness where the fires of multiple meanings blaze.
It is not necessary, in setting out on a journey of discovery, to carefully select, with great reliance on rules—even those dictated by taste—a fact classified as sublime. One can start from an everyday event: a falling handkerchief can be, for the poet, the lever with which he will lift an entire universe. We know what the sight of an apple falling meant to Newton—who, in this sense, could be called a poet. That is why today’s poet despises no movement of nature, and his mind pursues discovery just as much in the vastest and most elusive syntheses—crowds, nebulae, oceans, nations—as in seemingly simplest facts: a hand searching a pocket, a match lighting by friction, the cries of animals, the smell of gardens after the rain, a flame flickering in a fireplace.
Poets are not only the men of beauty. They are, above all, the men of truth, inasmuch as it allows them to penetrate the unknown, so much so that surprise—the unexpected—is one of the main driving forces of today’s poetry. And who would dare say that, for those who are worthy of joy, what is new is not also beautiful? Others will quickly tarnish and debase that sublime novelty, after which it may enter the realm of reason, but only within the limits where the poet—the sole dispenser of beauty and truth—has introduced it.
By the very nature of these explorations, the poet is isolated in the new world where he is the first to enter. His only consolation is that, ultimately, since humans live only on truths—despite the lies with which they pad them—it turns out that the poet alone nourishes the life in which humanity finds this truth. That is why modern poets are above all poets of truth—ever-renewing truth. And their task is infinite. They have surprised you, and they will surprise you even more. They are already imagining deeper designs than those that, through machination, gave birth to the useful and terrifying symbol of money.
Those who imagined the fable of Icarus, so marvelously realized today, will find others. They will take you, alive and awake, into the nocturnal and sealed world of dreams. Into the universes that pulse ineffably above our heads. Into those universes, both closer and more distant from us, which gravitate at the same point of infinity as the one we carry within us. And more wonders than those that have been born since the birth of the oldest among us will make contemporary inventions, of which we are so proud, seem pale and childish.
Finally, poets will be tasked with giving, through lyrical teleologies and archilyrical alchemies, an ever-purer meaning to the divine idea, which is within us—so alive and so true—which is this perpetual renewal of ourselves, this eternal creation, this ever-reborn poetry in which we live.
As far as we can tell, there are hardly any poets today outside of the French language.
All other languages seem to fall silent so that the universe may better listen to the voices of the new French poets.
The entire world looks toward this light, which alone illuminates the night that surrounds us.
And yet, here, these voices that rise up can barely be heard.
Modern poets are therefore creators, inventors, and prophets; they ask that what they say be examined for the greater good of the community to which they belong. They turn to Plato and beg him, if he must banish them from the Republic, at least to hear them first.
France, the guardian of all the secrets of civilization—secrets that remain secrets only due to the imperfection of those who strive to uncover them—has thus become, for much of the world, a seminary of poets and artists, who each day increase the wealth of its civilization.
And through the truth and joy they spread, they make this civilization, if not assimilable to any other nation, at least supremely delightful to all.
The French bring poetry to all peoples.
To Italy, where the example of French poetry has given rise to a young national school, superb in its audacity and patriotism.
To England, whose lyricism had faded and seemed nearly exhausted.
To Spain, and especially to Catalonia, where an entire ardent youth—who have already produced painters that honor both nations—follows with great attention the work of our poets.
To Russia, where the imitation of French lyricism has sometimes led to excess, which surprises no one.
To Latin America, where young poets passionately analyze their French predecessors.
To North America, to whom, in gratitude for Edgar Poe and Walt Whitman, French missionaries brought during the war the fertilizing element destined to bring about a new poetic production, the nature of which we do not yet know, but which will undoubtedly be worthy of these great pioneers of poetry.
France is full of schools that preserve and transmit lyricism, of groups where boldness is learned; yet one observation must be made: poetry owes itself first and foremost to the people in whose language it is expressed.
Poetic schools, before venturing into the heroic adventures of distant missions, must work to secure, establish, refine, expand, immortalize, and sing the greatness of the country that gave them birth, the country that nourished them and formed them, so to speak, from what is healthiest, purest, and best in its blood and its essence.
Has modern French poetry done for France all that it could?
Has it, at the very least, always been as active and dedicated in France as it has been elsewhere?
These are the questions that contemporary literary history naturally suggests, and to answer them, one would have to assess all that the new spirit carries within itself of the national and the fertile.
The new spirit is, above all, an enemy of aestheticism, formulas, and all snobbery. It does not fight against any particular school, for it does not wish to be a school, but rather one of the great currents of literature, encompassing all schools from symbolism to naturalism. It fights for the restoration of the spirit of initiative, for a clear understanding of its time, and to open new perspectives on the external and internal universe that are no less profound than those that scientists of all disciplines discover each day and from which they derive wonders.
These wonders impose on us the duty not to allow poetic imagination and subtlety to lag behind those of artisans improving a machine. Already, scientific language is in deep discord with that of poets. This is an intolerable situation. Mathematicians have the right to say that their dreams and concerns often surpass by a hundredfold the crawling imaginations of poets. It is up to the poets to decide whether they want to resolutely embrace the new spirit, for outside of it, only three doors remain open: that of pastiche, that of satire, and that of lamentation—however sublime it may be.
Can poetry be forced to confine itself to the margins of its surroundings, to ignore the magnificent exuberance of life that men, through their activity, add to nature, allowing them to engineer the world in the most astonishing ways?
The new spirit is the spirit of the very time in which we live. A time rich in surprises. Poets seek to tame prophecy, that fiery steed that has never been fully mastered.
They want, finally, one day, to engineer poetry as the world itself has been engineered. They want to be the first to provide an entirely new lyricism to these new means of expression, which add movement to art—those being the phonograph and cinema. They are still in the incunabula stage. But just wait—the wonders will speak for themselves, and the new spirit, which swells with life across the universe, will manifest itself powerfully in literature, in the arts, and in all things known.
ORIGINAL
Mercure de France 1er décembre 1918, tome 130, n° 491, (p. 385-396).
L’ESPRIT NOUVEAU
ET LES POÈTES
L’esprit nouveau qui dominera le monde entier ne s’est fait jour dans la poésie nulle part comme en France. La forte discipline intellectuelle que se sont imposée de tout temps les Français leur permet, à eux et à ceux qui leur appartiennent spirituellement, d’avoir une conception de la vie, des Arts et des Lettres qui, sans être la simple constatation de l’Antiquité, ne soit pas non plus un pendant du beau décor romantique.
L’esprit nouveau qui s’annonce prétend avant tout hériter des classiques un solide bon sens, un esprit critique assuré, des vues d’ensemble sur l’univers et dans l’âme humaine, et le sens du devoir qui dépouille les sentiments et en limite ou plutôt en contient les manifestations.
Il prétend encore hériter des romantiques une curiosité qui le pousse à explorer tous les domaines propres à fournir une matière littéraire qui permette d’exalter la vie sous quelque forme qu’elle se présente.
Explorer la vérité, la chercher, aussi bien dans le domaine ethnique, par exemple, que dans celui de l’imagination, voilà les principaux caractères de cet esprit nouveau.
Cette tendance du reste a toujours eu ses représentants audacieux qui l’ignoraient ; il y a longtemps qu’elle se forme, qu’elle est en marche.
Cependant, c’est la première fois qu’elle se présente consciente d’elle-même. C’est que, jusqu’à maintenant, le domaine littéraire était circonscrit dans d’étroites limites. On écrivait en prose ou l’on écrivait en vers. En ce qui concerne la prose, des règles grammaticales en fixaient la forme.
Pour ce qui est de la Poésie, la versification rimée en était la loi unique, qui subissait des assauts périodiques, mais que rien n’entamait.
Le vers libre donna un libre essor au lyrisme ; mais il n’était qu’une étape des explorations qu’on pouvait faire dans le domaine de la forme.
Les recherches dans la forme ont repris désormais une grande importance. Elle est légitime.
Comment cette recherche n’intéresserait-elle pas le poète, elle qui peut déterminer de nouvelles découvertes dans la pensée et dans le lyrisme ?
L’assonance, l’allitération, aussi bien que la rime sont des conventions qui chacune a ses mérites.
Les artifices typographiques poussés très loin avec une grande audace ont l’avantage de faire naître un lyrisme visuel qui était presque inconnu avant notre époque. Ces artifices peuvent aller très loin encore et consommer la synthèse des arts, de la musique, de la peinture et de la littérature.
Il n’y a là qu’une recherche pour aboutir à de nouvelles expressions parfaitement légitimes.
Qui oserait dire que les exercices de rhétorique, les variations sur le thème de : Je meurs de soif auprès de la fontaine n’ont pas eu une influence déterminante sur le génie de Villon ? Qui oserait dire que les recherches de forme des rhétoriqueurs et de l’école marotique n’ont pas servi à épurer le goût français jusqu’à sa parfaite floraison du XVIIe siècle ?
Il eût été étrange qu’à une époque où l’art populaire par excellence, le cinéma, est un livre d’images, les poètes n’eussent pas essayé de composer des images pour les esprits méditatifs et plus raffinés qui ne se contentent point des imaginations grossières des fabricants de films. Ceux-ci se raffineront, et l’on peut prévoir le jour où le phonographe et le cinéma étant devenus les seules formes d’impression en usage, les poètes auront une liberté inconnue jusqu’à présent.
Qu’on ne s’étonne point si, avec les seuls moyens dont ils disposent encore, ils s’efforcent de se préparer à cet art nouveau (plus vaste que l’art simple des paroles) où, chefs d’un orchestre d’une étendue inouïe, ils auront à leur disposition : le monde entier, ses rumeurs et ses apparences, la pensée et le langage humain, le chant, la danse, tous les arts et tous les artifices, plus de mirages encore que ceux que pouvait faire surgir Morgane sur le Mont Gibel, pour composer le livre vu et entendu de l’avenir.
Mais généralement vous ne trouverez pas en France de ces « paroles en liberté » jusqu’où ont été poussées les surenchères futuristes, italienne et russe, filles excessives de l’esprit nouveau, car la France répugne au désordre. On y revient volontiers aux principes, mais on a horreur du chaos.
Nous pouvons donc espérer, pour ce qui constitue la matière et les moyens de l’art, une liberté d’une opulence inimaginable. Les poètes font aujourd’hui l’apprentissage de cette liberté encyclopédique. Dans le domaine de l’inspiration, leur liberté ne peut pas être moins grande que celle d’un journal quotidien qui traite dans une seule feuille des matières les plus diverses, parcourt des pays les plus éloignés. On se demande pourquoi le poète n’aurait pas une liberté au moins égale et serait tenu, à une époque de téléphone, de télégraphie sans fil et d’aviation à plus de circonspection vis-à-vis des espaces.
La rapidité et la simplicité avec lesquelles les esprits se sont accoutumés à désigner d’un seul mot des êtres aussi complexes qu’une foule, qu’une nation, que l’univers n’avaient pas leur pendant moderne dans la poésie. Les poètes comblent cette lacune et leurs poèmes synthétiques créent de nouvelles entités qui ont une valeur plastique aussi composée que des termes collectifs.
L’homme s’est familiarisé avec ces êtres formidables que sont les machines, il a exploré le domaine des infiniment petits, et de nouveaux domaines s’ouvrent à l’activité de son imagination : celui de l’infiniment grand et celui de la prophétie.
Ne croyez pas toutefois que cet esprit nouveau soit compliqué, languissant, factice et glacé. Suivant l’ordre même de la nature, le poète s’est débarrassé de tout propos ampoulé. Il n’y a plus de wagnérisme en nous et les jeunes auteurs ont rejeté loin d’eux toute la défroque enchantée du romantisme colossal de l’Allemagne de Wagner, autant que les oripeaux agrestes de celui que nous avait valu Jean-Jacques Rousseau.
Je ne crois pas que les événements sociaux aillent si loin un jour qu’on ne puisse plus parler de littérature nationale. Au contraire, si loin qu’on aille dans la voie des libertés, celles-ci ne feront que renforcer la plupart des anciennes disciplines et il en surgira de nouvelles qui n’auront pas moins d’exigences que les anciennes. C’est pourquoi je pense que, quoi qu’il arrive, l’art, de plus en plus, aura une patrie. D’ailleurs, les poètes sont toujours l’expression d’un milieu, d’une nation, et les artistes, comme les poètes, comme les philosophes, forment un fonds social qui appartient sans doute à l’humanité, mais comme étant l’expression d’une race, d’un milieu donné.
L’art ne cessera d’être national que le jour où l’univers entier vivant sous un même climat, dans des demeures bâties sur le même modèle, parlera la même langue avec le même accent, c’est-à-dire jamais. Des différences ethniques et nationales naît la variété des expressions littéraires, et c’est cette même variété qu’il faut sauvegarder.
Une expression lyrique cosmopolite ne donnerait que des œuvres vagues sans accent et sans charpente, qui auraient la valeur des lieux communs de la rhétorique parlementaire internationale. Et remarquez que le cinéma, qui est l’art cosmopolite par excellence, présente déjà des différences ethniques immédiatement dissemblables à tout le monde, et les habitués de l’écran font immédiatement la différence d’un film américain et d’un film italien. De même l’esprit nouveau, qui a l’ambition de marquer l’esprit universel et qui n’entend pas limiter son activité à ceci ou à cela, n’en est pas moins, et prétend le respecter, une expression particulière et lyrique de la nation française, de même que l’esprit classique est, par excellence, une expression sublime de la même nation.
Il ne faut pas oublier qu’il est peut-être plus dangereux pour une nation de se laisser conquérir intellectuellement que par les armes. C’est pourquoi l’esprit nouveau se réclame avant tout de l’ordre et du devoir qui sont les grandes qualités classiques par quoi se manifeste le plus hautement l’esprit français, et il leur adjoint la liberté. Cette liberté et cet ordre qui se confondent dans l’esprit nouveau sont sa caractéristique et sa force.
Cependant cette synthèse des arts, qui s’est consommée de notre temps, ne doit pas dégénérer en une confusion. C’est-à-dire qu’il serait sinon dangereux du moins absurde, par exemple, de réduire la poésie à une sorte d’harmonie imitative qui n’aurait même pas pour excuse d’être exacte.
On imagine fort bien que l’harmonie imitative puisse jouer un rôle, mais elle ne saurait être la base que d’un art où les machines interviendraient ; par exemple, un poème ou une symphonie composés au phonographe pourraient fort bien consister en bruits artistement choisis et lyriquement mêlés ou juxtaposés, tandis que pour ma part, je conçois mal que l’on fasse consister tout simplement un poème dans l’imitation d’un bruit auquel aucun sens lyrique, tragique ou pathétique ne peut être attaché. Et si quelques poètes se livrent à ce jeu, il ne faut y voir qu’un exercice, une sorte de croquis des notes qu’ils inséreront dans une œuvre. Le « brékéké koax » des Grenouilles d’Aristophane n’est rien si on le sépare d’une œuvre où il prend tout son sens comique et satirique. Les iiii prolongés, durant toute une ligne, de l’oiseau de Francis Jammes sont d’une piètre harmonie imitative si on les détache d’un poème dont ils précisent toute la fantaisie.
Quand un poète moderne note à plusieurs voix le vrombissement d’un avion, il faut y voir avant tout le désir du poète d’habituer son esprit à la réalité. Sa passion de la vérité le pousse à prendre des notes presque scientifiques qui, s’il veut les présenter comme poèmes, ont le tort d’être pour ainsi dire des trompe-oreilles auxquels la réalité sera toujours supérieure.
Au contraire, s’il veut par exemple amplifier l’art de la danse et tenter une chorégraphie dont les baladins ne se borneraient point aux entrechats, mais pousseraient encore des cris ressortissant à l’harmonie d’une imitative nouveauté, c’est là une recherche qui n’a rien d’absurde, dont les sources populaires se retrouvent chez tous les peuples où les danses guerrières, par exemple, sont presque toujours agrémentées de cris sauvages.
Pour revenir au souci de vérité, de vraisemblance qui domine toutes les recherches, toutes les tentatives, tous les essais de l’esprit nouveau, il faut ajouter qu’il n’y a pas lieu de s’étonner si un certain nombre et même beaucoup d’entre eux restaient momentanément stériles et sombraient même dans le ridicule. L’esprit nouveau est plein de dangers, plein d’embûches.
Tout cela ressortit pourtant à l’esprit d’aujourd’hui et condamner en bloc ces tentatives, ces essais, serait faire une erreur dans le genre de celle qu’à tort ou à raison on attribue à M. Thiers, qui aurait déclaré que les chemins de fer n’étaient qu’un jeu scientifique et que le monde ne pourrait produire assez de fer pour construire des rails de Paris à Marseille.
L’esprit nouveau admet donc les expériences littéraires même hasardeuses, et ces expériences sont parfois peu lyriques. C’est pourquoi le lyrisme n’est qu’un domaine de l’esprit nouveau dans la poésie d’aujourd’hui, qui se contente souvent de recherches, d’investigations, sans se préoccuper de leur donner de signification lyrique. Ce sont des matériaux qu’amasse le poète, qu’amasse l’esprit nouveau, et ces matériaux formeront un fond de vérité dont la simplicité, la modestie ne doit point rebuter, car les conséquences, les résultats peuvent être de grandes, de bien grandes choses.
Plus tard, ceux qui étudieront l’histoire littéraire de notre temps s’étonneront que, semblables aux alchimistes, des rêveurs, des poètes aient pu, sans même le prétexte d’une pierre philosophale, s’adonner à des recherches, à des notations qui les mettaient en butte aux railleries de leurs contemporains, des journalistes et des snobs.
Mais leurs recherches seront utiles ; elles constitueront les bases d’un nouveau réalisme qui ne sera peut-être pas inférieur à celui si poétique et si savant de la Grèce antique.
Nous avons vu aussi depuis Alfred Jarry le rire s’élever des basses régions où il se tordait et fournir au poète un lyrisme tout neuf. Où est le temps où le mouchoir de Desdémone paraissait d’un ridicule inadmissible ? Aujourd’hui, le ridicule même est poursuivi, on cherche à s’en emparer et il a sa place dans la poésie, parce qu’il fait partie de la vie au même titre que l’héroïsme et tout ce qui nourrissait jadis l’enthousiasme des poètes.
Les romantiques ont essayé de donner aux choses d’apparence grossière un sens horrible ou tragique. Pour mieux dire, ils n’ont travaillé qu’en faveur de l’horrible. Ils ont voulu acclimater l’horreur bien plus que la mélancolie. L’esprit nouveau ne cherche pas à transformer le ridicule, il lui conserve un rôle qui n’est pas sans saveur. De même, il ne veut pas donner à l’horrible le sens du noble. Il le laisse horrible et n’abaisse pas le noble. Ce n’est pas un art décoratif, ce n’est pas non plus un art impressionniste. Il est tout étude de la nature extérieure et intérieure, il est tout ardeur pour la vérité.
Même s’il est vrai qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil, il ne consent point à ne pas approfondir tout ce qui n’est pas nouveau sous le soleil. Le bon sens est son guide et ce guide le conduit en des coins sinon nouveaux, du moins inconnus.
Mais n’y a-t-il rien de nouveau sous le soleil ? Il faudrait voir.
Quoi ! on a radiographié ma tête. J’ai vu, moi vivant, mon crâne, et cela ne serait en rien de la nouveauté ? À d’autres !
Salomon parlait sans doute pour la reine de Saba, et il aimait tant la nouveauté que ses concubines étaient innombrables.
Les airs se peuplent d’oiseaux étrangement humains. Des machines, filles de l’homme et qui n’ont pas de mère, vivent une vie dont les passions et les sentiments sont absents, et cela ne serait point nouveau !
Les savants scrutent sans cesse de nouveaux univers qui se découvrent à chaque carrefour de la matière, et il n’y aurait rien de nouveau sous le soleil. Pour le soleil, peut-être. Mais pour les hommes !
Il y a mille et mille combinaisons naturelles qui n’ont jamais été composées. Ils les imaginent et les mènent à bien, composant ainsi avec la nature cet art suprême qu’est la vie. Ce sont ces nouvelles combinaisons, ces nouvelles œuvres de l’art de vie, que l’on appelle le progrès. En ce sens, il existe. Mais si on le fait consister dans un éternel devenir, dans une sorte de messianisme, aussi épouvantable que ces fables de Tantale, de Sisyphe et de Danaïde, alors Salomon a raison contre les prophètes d’Israël.
Mais le nouveau existe bien, sans être en progrès. Il est tout dans la surprise. L’esprit nouveau est également dans la surprise. C’est ce qu’il y a en lui de plus vivant, de plus neuf. La surprise est le grand ressort nouveau. C’est par la surprise, par la place importante qu’il fait à la surprise que l’esprit nouveau se distingue de tous les mouvements artistiques et littéraires qui l’ont précédé.
Ici, il se détache de tous et n’appartient plus qu’à notre temps.
Nous l’avons établi sur les solides bases du bon sens et de l’expérience, qui nous ont amenés à n’accepter les choses et les sentiments que selon la vérité, et c’est selon la vérité que nous les admettons, ne cherchant point à rendre sublime ce qui naturellement est ridicule ou réciproquement. Et de ces vérités il résulte le plus souvent la surprise, puisqu’elles vont contre l’opinion communément admise. Beaucoup de ces vérités n’avaient pas été examinées. Il suffit de les dévoiler pour causer une surprise.
On peut également exprimer une vérité supposée qui cause la surprise, parce qu’on n’avait point encore osé la présenter. Mais une vérité supposée n’a point contre elle le bon sens, sans quoi elle ne serait plus la vérité, même supposée. C’est ainsi que si j’imagine que, les femmes ne faisant point d’enfants, les hommes pourraient en faire et que je le montre, j’exprime une vérité littéraire qui ne pourra être qualifiée de fable que hors de la littérature, et je détermine la surprise. Mais ma vérité supposée n’est pas plus extraordinaire, ni plus invraisemblable que celles des Grecs, qui montraient Minerve sortant armée de la tête de Jupiter.
Tant que les avions ne peuplaient pas le ciel, la fable d’Icare n’était qu’une vérité supposée. Aujourd’hui ce n’est plus une fable. Et nos inventeurs nous ont accoutumés à des prodiges plus grands que celui qui consisterait à déléguer aux hommes la fonction qu’ont les femmes de faire des enfants. Je dirai plus, les fables s’étant pour la plupart réalisées et au delà c’est au poète d’en imaginer des nouvelles que les inventeurs puissent à leur tour réaliser.
L’esprit nouveau exige qu’on se donne de ces tâches prophétiques. C’est pourquoi vous trouverez trace de prophétie dans la plupart des ouvrages conçus d’après l’esprit nouveau. Les jeux divins de la vie et de l’imagination donnent carrière à une activité poétique toute nouvelle.
C’est que poésie et création ne sont qu’une même chose ; on ne doit appeler poète que celui qui invente, celui qui crée, dans la mesure où l’homme peut créer. Le poète est celui qui découvre de nouvelles joies, fussent-elles pénibles à supporter. On peut être poète dans tous les domaines : il suffit que l’on soit aventureux et que l’on aille à la découverte.
Le domaine le plus riche, le moins connu, celui dont l’étendue est infinie, étant l’imagination, il n’est pas étonnant que l’on ait réservé plus particulièrement le nom de poète à ceux qui cherchent les joies nouvelles qui jalonnent les énormes espaces imaginatifs.
Le moindre fait est pour le poète le postulat, le point de départ d’une immensité inconnue où flambent les feux de joie des significations multiples.
Il n’est pas besoin pour partir à la découverte de choisir à grand renfort de règles, même édictées par le goût, un fait classé comme sublime. On peut partir d’un fait quotidien : un mouchoir qui tombe peut être pour le poète le levier avec lequel il soulèvera tout un univers. On sait ce que la chute d’une pomme vue par Newton fut pour ce savant que l’on peut appeler un poète. C’est pourquoi le poète d’aujourd’hui ne méprise aucun mouvement de la nature, et son esprit poursuit la découverte aussi bien dans les synthèses les plus vastes et les plus insaisissables : foules, nébuleuses, océans, nations, que dans les faits en apparence les plus simples : une main qui fouille une poche, une allumette qui s’allume par le frottement, des cris d’animaux, l’odeur des jardins après la pluie, une flamme qui naît dans un foyer. Les poètes ne sont pas seulement les hommes du beau. Ils sont encore et surtout les hommes du vrai, en tant qu’il permet de pénétrer dans l’inconnu, si bien que la surprise, l’inattendu, est un des principaux ressorts de la poésie d’aujourd’hui. Et qui oserait dire que, pour ceux qui sont dignes de la joie, ce qui est nouveau ne soit pas beau ? Les autres se chargeront vite d’avilir cette nouveauté sublime, après quoi elle pourra entrer dans le domaine de la raison, mais seulement dans les limites où le poète, seul dispensateur du beau et du vrai, en aura fait la proposition.
Le poète, par la nature même de ces explorations, est isolé dans le monde nouveau où il entre le premier, et la seule consolation qu’il lui reste c’est que les hommes, finalement, ne vivant que de vérités, malgré les mensonges dont ils les matelassent, il se trouve que le poète seul nourrit la vie où l’humanité trouve cette vérité. C’est pourquoi les poètes modernes sont avant tout les poètes de la vérité toujours nouvelle. Et leur tâche est infinie ; ils vous ont surpris et vous surprendront plus encore. Ils imaginent déjà de plus profonds desseins que ceux qui machiavéliquement ont fait naître le signe utile et épouvantable de l’argent.
Ceux qui ont imaginé la fable d’Icare, si merveilleusement réalisée aujourd’hui, en trouveront d’autres. Ils vous entraîneront tout vivants et éveillés dans le monde nocturne et fermé des songes. Dans les univers qui palpitent ineffablement au-dessus de nos têtes. Dans ces univers plus proches et plus lointains de nous qui gravitent au même point de l’infini que celui que nous portons en nous. Et plus de merveilles que celles qui sont nées depuis la naissance des plus anciens d’entre nous feront pâlir et paraître puériles les inventions contemporaines dont nous sommes si fiers.
Les poètes enfin seront chargés de donner par les téléologies lyriques et les alchimies archilyriques un sens toujours plus pur à l’idée divine, qui est en nous si vivante et si vraie, qui est ce perpétuel renouvellement de nous-mêmes, cette création éternelle, cette poésie sans cesse renaissante dont nous vivons.
D’après ce que l’on peut savoir, il n’y a guère de poètes aujourd’hui que de langue française.
Toutes les autres langues semblent faire silence pour que l’univers puisse mieux écouter la voix des nouveaux poètes français.
Le monde entier regarde vers cette lumière, qui seule éclaire la nuit qui nous entoure.
Ici cependant ces voix qui s’élèvent se font à peine entendre.
Les poètes modernes sont donc des créateurs, des inventeurs et des prophètes ; ils demandent qu’on examine ce qu’ils disent pour le plus grand bien de la collectivité à laquelle ils appartiennent. Ils se tournent vers Platon et le supplient, s’il les bannit de la République, d’au moins les entendre auparavant.
La France, détentrice de tout le secret de la civilisation, secret qui n’est secret qu’à cause de l’imperfection de ceux qui s’efforcent de le deviner, est de ce fait devenue pour la plus grande partie du monde un séminaire de poètes et d’artistes, qui augmentent chaque jour le patrimoine de sa civilisation.
Et, par la vérité et par la joie qu’ils répandent, ils rendent cette civilisation, sinon assimilable à quelque nation que ce soit, du moins suprêmement agréable à toutes.
Les Français portent la poésie à tous les peuples.
En Italie, où l’exemple de la poésie française a donné l’essor à une jeune école nationale superbe d’audace et de patriotisme.
En Angleterre, dont le lyrisme s’était affadi et pour ainsi dire épuisé.
En Espagne et surtout dans la Catalogne, où toute une jeunesse ardente, qui a déjà produit des peintres qui honorent les deux nations, suit avec attention les productions de nos poètes.
En Russie, où l’imitation du lyrisme français à parfois donné lieu à la surenchère, ce qui n’étonnera personne.
À l’Amérique latine, où les jeunes poètes commentent avec passion leurs devanciers français.
À l’Amérique du Nord, à laquelle, en reconnaissance d’Edgard Poe et de Walt Whitman, des missionnaires français apportent pendant la guerre l’élément fécondateur destiné à amener une production nouvelle dont nous n’avons pas encore idée, mais qui sans doute ne sera pas inférieure à ces grands pionniers de la poésie.
La France est pleine d’écoles où se garde et se transmet le lyrisme, de groupements où s’apprend l’audace ; cependant une remarque s’impose : une poésie se doit tout d’abord au peuple dans la langue duquel elle s’exprime.
Les écoles poétiques, avant de se jeter dans les héroïques aventures des apostolats lointains, doivent opérer, assurer, préciser, augmenter, immortaliser, chanter la grandeur du pays qui leur a donné naissance, du pays qui les a nourries et les a formées, pour ainsi dire, de ce qu’il y a de plus sain, de plus pur et de meilleur dans son sang et dans sa substance.
La poésie française moderne a-t-elle fait pour la France tout ce qu’elle pourrait faire ?
A-t-elle du moins été toujours, en France, aussi active, aussi zélée qu’elle l’a été ailleurs ?
Ces questions, l’histoire littéraire contemporaine suffit à les suggérer, et pour les résoudre il faudrait pouvoir supputer tout ce que l’esprit nouveau porte en lui de national et de fécond.
L’esprit nouveau est avant tout ennemi de l’esthétisme, des formules et de tout snobisme. Il ne lutte point contre quelque école que ce soit, car il ne veut pas être une école, mais un des grands courants de la littérature englobant toutes les écoles, depuis le symbolisme et le naturisme. Il lutte pour le rétablissement de l’esprit d’initiative, pour la claire compréhension de son temps et pour ouvrir des vues nouvelles sur l’univers extérieur et intérieur qui ne soient point inférieures à celles que les savants de toutes catégories découvrent chaque jour et dont ils tirent des merveilles.
Les merveilles nous imposent le devoir de ne pas laisser l’imagination et la subtilité poétique derrière celle des artisans qui améliorent une machine. Déjà, la langue scientifique est en désaccord profond avec celle des poètes. C’est un état de choses insupportable. Les mathématiciens ont le droit de dire que leurs rêves, leurs préoccupations dépassent souvent de cent coudées les imaginations rampantes des poètes. C’est aux poètes à décider s’ils ne veulent point entrer résolument dans l’esprit nouveau, hors duquel il ne reste d’ouvertes que trois portes : celle des pastiches, celle de la satire et celle de la lamentation, si sublime soit-elle.
Peut-on forcer la poésie à se cantonner hors de ce qui l’entoure, à méconnaître la magnifique exubérance de vie que les hommes par leur activité ajoutent à la nature et qui permet de machiner le monde de la façon la plus incroyable ?
L’esprit nouveau est celui du temps même où nous vivons. Un temps fertile en surprises. Les poètes veulent dompter la prophétie, cette ardente cavale que l’on n’a jamais maîtrisée.
Ils veulent enfin, un jour, machiner la poésie comme on a machiné le monde. Ils veulent être les premiers à fournir un lyrisme tout neuf à ces nouveaux moyens d’expression qui ajoutent à l’art le mouvement et qui sont le phonographe et le cinéma. Ils n’en sont encore qu’à la période des incunables. Mais attendez, les prodiges parleront d’eux-mêmes et l’esprit nouveau, qui gonfle de vie l’univers, se manifestera formidablement dans les lettres, dans les arts et dans toutes les choses que l’on connaisse.
Additional Notes from studies (gathered 3/16/2025)
Apollinaire stressed the importance of what he perceived as virtues of the plastic arts: purity, unity, and truth; all of which would keep "nature in subjection". He deplored the violent attacks waged against the Cubist's preoccupation with geometry; geometrical figures being the essence of drawing. "Geometry, the science of space, its dimensions and relations, has always determined the norms and rules of painting."
Before Cubism, the three dimensions of Euclidean geometry had been sufficient for artists. But according to Apollinaire, "geometry is to the plastic arts what grammar is to the art of the writer". Artists, just as scientists, no longer had to limit themselves to three spatial dimensions. They were guided by intuition, to preoccupy themselves with the new possibilities of spatial measurement which included the 'fourth dimension'. This realm represented the "immensity of space eternalizing itself in all directions at any given moment". This expression stood for the aspiration and premonitions of artists who contemplated Egyptian, African, and oceanic sculptures; who meditated on various scientific works, and who lived "in anticipation of a sublime art".[28]
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cubist_Painters,_Aesthetic_Meditations